
Quel revêtement perméable carrossable : critères de choix pour PL, voie-pompiers, etc.
Découvrez comment choisir un revêtement perméable carrossable résistant au trafic lourd, aux intempéries et conforme aux normes environnementales.
A proximité des zones urbanisées où les terrains se font de plus en plus chers et rares, ou tout simplement dans les régions à pluviométrie importante, vous pourrez utiliser, grâce à nos dalles drainantes, les surfaces aménagées tout au long de l’année sans formation de flaques ou d’apparition de boue.
La société ECOVEGETAL propose ainsi des solutions techniques durables pour la stabilisation et de drainage des sols : stabilisation de talus et de berges, création de liaisons douces, stabilisation d’accotements routiers, stabilisations de sols agricoles, etc.
Est-ce vraiment nécessaire ? Éviter les flaques de boue, lutter contre l’érosion, les talus qui s’effondrent sur la route : quand on cherche à stabiliser un sol, on cherche avant tout à prévenir ces dégâts (ou à éviter qu’ils ne se reproduisent quand c’est déjà fait). C’est à la fois une question de coût d’entretien et de facilité d’usage.
Or, le lien entre ces problèmes courants – et le véritable enjeu en matière de stabilisation des sols – c’est la gestion de l’eau.
Qu’on parle d’un terrain agricole, d’un jardin public, d’allées piétonnes en ville, de talus et bords de chemins, tous sont concernés par deux problématiques : le ruissellement ou l’infiltration de l’eau.
Selon la nature du sol (argile, calcaire, etc.), l’eau le dégradera plus ou moins rapidement (gonflement, altération) et viendra altérer son usage. On stabilise donc un sol pour à améliorer sa résistance mécanique et sa durabilité… sous des contraintes de gestion des eaux pluviales.
Un sol stabilisé se maintient sous la pression des éléments extérieurs comme le poinçonnement des véhicules ou l’érosion. Pour cela, on a choisi d’améliorer ses performances techniques. Souvent en suivant un réflexe classique et malheureusement erroné. Il suffit de saisir « stabilisation de sols » sur un moteur de recherche pour qu’on vous propose aussitôt d’assécher, lier, puis compacter un sol pour améliorer la portance.
La démarche d’ECOVEGETAL est à l’opposé. On stabilisera un sol en améliorant ses propriétés naturelles plutôt qu’en cherchant à les compenser, voire les annihiler. Nos solutions de stabilisation des sols reposent sur des dalles alvéolaires (et des grilles pour les talus) et un remplissage de matériaux naturels (terre amendée, mélange minéral…) qui laissent passer l’eau mais retiennent les composants du sol.

Résistance au poinçonnement, cisaillage, passage de véhicules lourds

Réduit le ruissellement, lutte contre les inondations, infiltration de toutes les eaux de pluie

Végétalisation des berges et talus, réduction du risque d’effondrements et glissements de terrain

Longue durabilité dans le temps, rares passages annuels d’entretien, contribue à la qualité du paysage
On a encore le réflexe, aujourd’hui, de vouloir compenser des sols naturels.
Tout se passe comme si la notion même de stabilisation de sol était une notion chimique. Comme s’il y avait, dans la nature, des sols « non conformes » du point de vue chimique. Des sols qu’il faut donc lier avec du ciment, de la chaux, etc.Et qu’il faut donc ensuite passer au compactage pour qu’ils « tiennent » et résistent à l’eau.
En gros, il s’agit de transformer le sol, cette ressource si rare à la surface de la planète, en quelque chose de l’ordre de la pierre inerte !
Il s’agit de combattre à tout prix la porosité, qui serait forcément porteuse d’instabilité. En bref, mieux vaut un bon vieil enrobé béton pour faire circuler un camion, qu’un chemin en terre humide. Non ?
Ce raisonnement est encore plus tenace quand on parle de terrain agricole ou d’un espace qui doit voir passer des engins lourds, des animaux au pas lourd, etc. On envisage automatiquement un sol rendu compact par un liant de chaux ou de ciment, ou en construisant un ouvrage bétonné. Ce sont des concepts en apparence rassurants. Sauf qu’en fait de sécurité, ces choix de techniques peuvent contribuer à déstabiliser vos sols en maintenant l’engrenage qui refuse le cycle de l’eau.
En effet, une utilisation intensive et une mauvaise gestion des pluies (imperméabilisation des surfaces) dégradent le sol. Son comportement mécanique va à l’encontre de la réaction souhaitée. On constate alors des coulées de boue, de l’érosion et des glissements de talus, des sols agricoles gorgés d’eau et impraticables, etc.
En réalité, contrairement à la logique du « tout béton, tout solide », la stabilisation des sols passe par le retour à la perméabilité.
Pour lutter contre l’érosion des talus ou des berges, l’idée est d’obtenir un sol perméable. Oui, un sol qui va absorber de l’eau.
Cette affirmation semble absurde ? C’est pourtant la solution qui fonctionne le mieux aujourd’hui. Un sol qui boit l’eau est moins boueux qu’un sol qui la rejette. Un sol capable d’infiltrer le maximum d’eau de pluie permet d’offrir une portance utile à tous les usages qu’on lui destine. On n’obtient pas un sol plus faible, au contraire…
La clé de cet exploit ?
Les solutions de stabilisation des sols sont formées de plusieurs couches drainantes. Terre, substrat, graviers, pouzzolane, des matériaux qui s’additionnent et vont filtrer les eaux de pluie jusqu’à leurs exutoires (sous-sols phréatiques, drains, fleuves et cours d’eaux naturels…).
On va choisir bien évidemment des matériaux naturellement drainants. Et on va adapter le dispositif choisi au type de sol. Même en cas de sol trop argileux et gorgé d’eau, la fameuse « terre amoureuse » qui colle aux bottes. Ou en cas de sol friable qui s’érode…
Après avoir procédé à une analyse de vos sols et adapté la solution drainante idéale, vous pouvez parvenir à un terrain qui boit toute l’eau de pluie sans flaques ni boues. Découvrez ici les solutions ECOVEGETAL qui le permettent.
Vous imaginez difficilement le passage d’un camion ou tracteur sur un sol drainant ? L’image des roues enfoncées dans la gadoue vous hante ? Détendez-vous.
La portance des sols stabilisés est obtenue par la pose d’un système de dalles alvéolaires. Comme vous pouvez le lire ici, les dalles en alvéoles se clipsent entre elles pour former une surface résistante, à la fois souple et solide.

Découvrez comment choisir un revêtement perméable carrossable résistant au trafic lourd, aux intempéries et conforme aux normes environnementales.

Découvrez les meilleures solutions pour retenir la terre d’un talus : murs, gabions, végétalisation, et systèmes innovants pour une stabilisation durable.
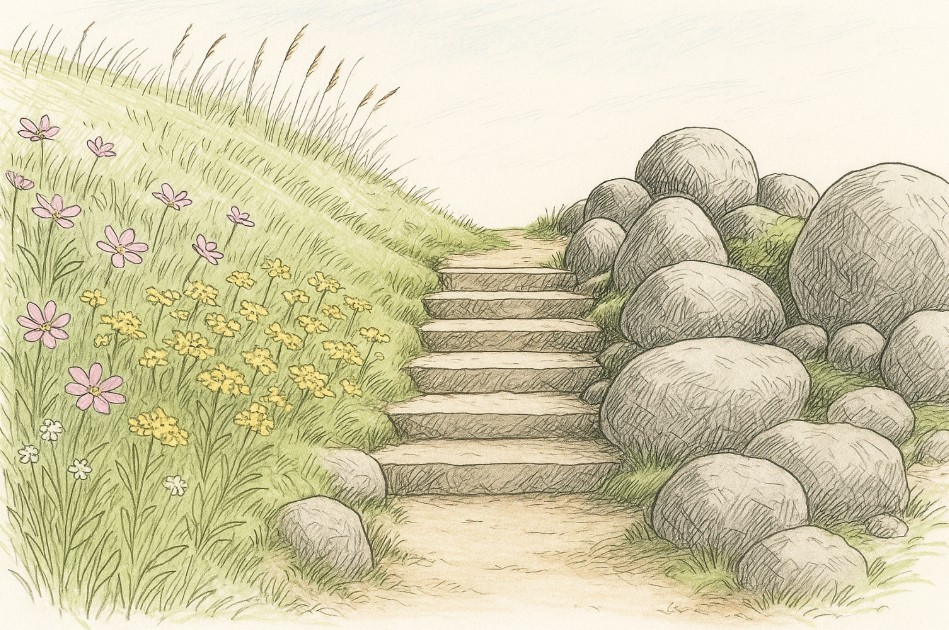
Comment aménager un jardin en pente ? Vous souhaitez aménager un terrain en pente ? Partez d’un principe simple :